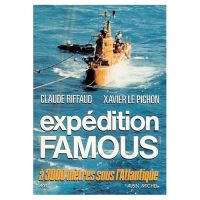| |
|
|
|
|
|
|
Evaluation
par les enseignants de l'intérêt didactique des nouveaux
sites proposés, dans le cadre de la préparation d'une
école de terrain en première S.
Evaluation
réalisée en partenariat avec l'équipe de
didactique de la géologie de l'Institut national de recherche
pédagogique (INRP), la géologue Françoise Chalot-Prat
et les enseignants du lycée de Trévoux (académie
de Lyon) et du lycée de Villeuneuve (académie de Versailles),
en août 2006.
C'est
le lycée du Val de Saône de Trévoux (académie
de Lyon) qui expérimentera la première école de
terrain sur le site du Rocher de l'Aigle, à proximité
du col de Souréou, en octobre 2006 (cartographie des contacts
gabbros-péridotites, gabbros-basaltes mais surtout basaltes-péridotites).
L'originalité
de cette école est de mettre les élèves
en situation d'exploration active du site, avec support cartographique
et GPS, sur le modèle proposé par le structuraliste Patrick
Ledru du BRGM aux étudiants en sciences de la Terre de l'université
de Lyon.
|
|
|
|
|
|
En
août 2007, reconstitution des paysages glaciaires sur le
secteur du Rocher de l'Aigle, avec la participation active de Claude
Beaudevin, ingénieur (Centrale) et retraité, auteur du
site Paysages
glaciaires.
Le
cirque du Rocher de l'Aigle (d'après Beaudevin, 2007)
:
Compte
tenu de son exposition nord et de l'altitude importante des sommets,
ce versant du Rocher de l'Aigle a été occupé, à
chaque glaciation, en tout cas au Würm et au Riss, par des glaciers
de cirque. Au maximum de chaque glaciation, ceux-ci s'étendaient
depuis le haut des pentes douces du fond de cirque (en dessous des pentes
plus raides qui mènent aux sommets) jusqu'à rejoindre
le glacier principal aux alentours de 2200 m. De tels glaciers de cirque
laissent en général peu de traces de leur passage, si
ce n'est, à grande échelle, la forme du cirque lui-même.
Ici, cette forme est très typique.
Voir le
site de Beaudevin à ce propos.
Les formes
de dépôts sont rares en montagne et la carte géologique
n'en
indique pas dans cette zone, ce qui ne prouve d'ailleurs rien, étant
donné l'indifférence
de certains géologues alpins pour les dépôts glaciaires.
Quant aux formes d'érosion de petite taille, elles ne peuvent
subsister très longtemps que dans les roches très compétentes,
ce qui n'est pas le cas ici, les basaltes en coussins étant peu
résistants à l'érosion. On ne peut donc espérer
trouver que des formes de grande taille, pas dans le cirque lui-même
mais sur ses limites.
C'est bien le cas ici, où il existe, à l'emplacement de
la gare supérieure du télécabine des Chalmettes,
un épaulement à 2200 m, ce qui donne une altitude de glacier
de vallée à 2250 m environ. De l'autre côté
du cirque, à l'emplacement de la borne frontière ZH figurant
sur la carte IGN au 25.000e, un autre épaulement est identifiable
aux alentours de 2031 m, avec probablement des sillons entre la côte
2031 et la borne frontière ZH (simple intuition car la carte
au 25.000e ne permet pas d'en être sûr).
Quoiqu'il en soit, le sommet d'épaulement se situant à
2015 m environ, l'altitude du glacier devait être à 2065
m.
|
Le
glacier de cirque du Chenaillet s'est installé à cet endroit
parce qu'il y existait une forme de relief en creux qui se prêtait
à l'accumulation de la neige. Cela a commencé par une combe
à neige puis, au fil des glaciations, le creux s'est approfondi
et a pu abriter un glacier important. La forme de relief en creux qui
a été l'initiatrice du glacier peut être due à
la tectonique ou à d'autres types d'érosion antérieurs
aux glaciations, par exemple une érosion torrentielle.
Voir la description
de ce type de formation.
Au
final, la face ouest du Chenaillet présente un relief tout
à fait caractéristique des pentes supérieures d'un
cirque glaciaire. Elle a été, ainsi que les arêtes
qui en partent, travaillée par les cycles gel-dégel propres
à la haute montagne. Il ne s'agit nullement de formes glaciaires,
mais d'un relief périglaciaire ; les glaciers ne sont jamais montés
aussi haut. Ce type de relief est à rapprocher de celui
des
aiguilles de Chamonix (voir
les travaux de Beaudevin sur la
Vallée étroite).
Comment
dater la présence du glacier du Rocher de l'Aigle ?
Pour des généralités, voyez
cette page.
Le cirque glaciaire du Rocher de l'Aigle a été occupé
au Würm et au Riss comme à chacune des glaciations précédentes
un peu importantes mais dont il ne reste, bien entendu pas de traces.
Plaçons-nous au début du Würm. Un glacier de cirque
apparaît dans les pentes supérieures du cirque. À
ce moment, le glacier de la Clarée suit le lit de cette rivière
jusqu'à Briançon et celui de la vallée Étroite
s'écoule dans le lit du torrent de Rochemolle. Il n'y a pas de
glace au Montgenévre. Le froid progresse. Le glacier de cirque
descend de plus en plus bas, cependant que le niveau des glaciers de vallée
s'élève. La glace s'écoule par-dessus le col et on
arrive à la
situation représentée sur la carte Beaudevin 2007.
À la décrue glaciaire, le glacier de cirque, doté
d'une inertie plus faible que ceux de vallée, diminue plus vite
que ceux-ci. Mais le Montgenévre n'est pas occupé par le
glacier de vallée lui-même, mais par une diffluence en direction
de l'Italie. Or, lorsqu'une glaciation prend fin, ce sont les diffluences
qui disparaissent les premières; il s'agit en quelque sorte de
surverses.
Est-ce le glacier de cirque qui a reculé le plus vite ou celui
de la diffluence du Montgenévre qui s'est abaissé le premier
? Il ne n'est pas possible de le dire et il est donc très difficile
voire impossible pour l'instant, de dater ces diverses phases. On peut
donner que des ordres de grandeur : 20 000 ans pour le maximum du Würm,
15 000 pour la fin de la glace dans le Montgenévre, 10 000 ans
pour un net recul des glaciers. Mais encore une fois, ce ne sont que des
ordres de grandeur.
|
|
Cécile
Miramont, maître de conférence à l'Université
de Provence (Institut
Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie)
a proposé une activité de réparage sur la carte
IGN des traces de présence du glacier wurmien dans notre secteur
d'étude. Il s'agira ensuite avec des élèves d'aller
confirmer sur le terrain la présence de ces indices de présence
glaciaire.
La cartographie
ci-contre est donc une proposition à vérifier sur le terrain
:
En
rouge
: le secteur du Chenaillet qui devait être émergé
durant le Würm. Repérage probable grâce à la
topographie et à la présence des lacs et tourbières
d'origine glaciaire, au dessous de 2200 mètres d'altitude.
En vert : probables
formes de moraines (mises en place au moment de la fonte) en avant de
certains lacs et tourbières d'origine glaciaire.
Formes repérables sur la carte topographique IGN par les déformations
des courbes de
niveau. Elles font "un ventre" en aval des lacs.
|
«Adieu donc, ma sœur
Durance,
Nous nous séparons sur ce mont :
Toi, tu vas ravager la France,
Je vais féconder le Piémont.» |
Le
réseau hydrographique actuel :
La Durance n’est ici qu’un
minuscule ruisseau, descendant des contreforts du Col de Montgenèvre,
un des principaux passages humains à travers les Alpes. La source
de cette rivière de la Provence se situe exactement sur le versant
sud du col, au fond du vallon du Gondran, entre les deux sommets du
Chenaillet (2650 m) et du Janus (2529 m).
De
l’autre côté de la ligne de partage des eaux, il
en va de même pour la Doire,
mais celle-ci prend plus bas le nom de la rivière qu’elle
rencontre, la Ripa, et devient la Doire Ripaire (en italien, Dora Riparia).
|
|
|
|
|
A
partir de la mise en cohérence d'observations de terrain et de
la réalisation de relevés cartographiques, co-construits
avec les élèves, on tente d'élaborer un modèle
de lithosphère océanique correspondant à l'ophiolite
du Chenaillet.
Compte-rendu en cours de préparation avec l'enseignant pilote,
Lionel Cauchi, professeur de SVT au lycée Georges Pompidou...
 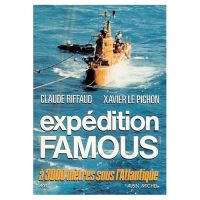
|


|
On
confronte les observations avec celles réalisées lors de
la campagne
d'exploration scientifique FAMOUS (French American Mid Oceanic Undersea
Study) en 1975 avec Xavier Le Pichon. Il s'agit d'une campagne d'exploration
sous-marine franco-américaine d’une partie de la dorsale
médio Atlantique, au large des Açores. Réalisée
au cours des étés 1973 et 1974, à une profondeur
de 3000 mètres, cette expédition a permis une cartographie
précise au moyen de bathyscaphes.
Choix de
séquences du film d'intéret pédagogique (durée
totale : 33 mn)
- 0 à
5’18 : présentation de l’expédition ;
-
14’58
à 17’02 : comparaison des observations en surface et
en profondeur ;
-
20’31
à 23’40 : mécanisme de mise en place des pillows
;
-
27’40
à 28’03 : conclusion.
|
|
|